
Trop long à lire
Bugonia de Yorgos Lanthimos transforme une prise d’otage absurde en fable sur la paranoïa moderne. Emma Stone et Jesse Plemons brillent dans ce thriller satirique à la mise en scène glaciale et précise. Innovant mais déroutant, le film confirme Lanthimos comme maître du malaise intelligent et du cinéma provocateur.
Le retour d’un maître de l’étrange
À chaque nouveau film, Yorgos Lanthimos semble s’amuser à déplacer les limites du burlesque noir et de la dystopie intime. Bugonia confirme cette trajectoire : ce n’est ni une simple satire ni un thriller standard, mais une fable absurde qui emprunte autant au cinéma de genre qu’à la satire sociale. Porté par Emma Stone et Jesse Plemons, le film s’est imposé en compétition à la Mostra de Venise 2025 et suscite déjà un débat — entre admiration pour l’audace formelle et interrogation sur la cohérence narrative. Les éléments factuels sur le projet, son casting, sa genèse et sa réception sont rassemblés et vérifiés ci-dessous pour servir cette lecture critique.
Une prise d’otage qui devient fable planétaire
Teddy, un apiculteur obsédé par les théories du complot, convainc son cousin Don que Michelle Fuller, patronne d’un géant pharmaceutique, est une envahisseuse extra-terrestre responsable de la disparition des abeilles et des maux modernes. Avec l’obstination de qui croit tenir la sauvegarde de l’humanité, ils kidnappent Michelle, la rasent et l’enferment dans leur sous-sol, décidés à forcer une confession ou une réparation. Ce canevas, simple en apparence, se déploie en une série d’échanges où s’affrontent logique paranoïaque, rhétorique corporative et absurdité tragique — jusqu’à ouvrir des pistes sur la responsabilité des institutions, la folie politique et la fragilité des certitudes humaines.
Lanthimos, l’art de rendre crédible l’incongru
Yorgos Lanthimos n’est plus un inconnu : après The Favourite puis Poor Things, il a acquis une réputation pour creuser l’étrange avec une mise en scène d’une froide précision et un sens du grotesque jamais gratuit. Bugonia prolonge sa veine : il réinterprète un matériau sud-coréen — le film Save the Green Planet! (2003) — en y injectant sa signature formelle et thématique. Lanthimos s’empare de la réécriture pour questionner notre époque : technologie intrusive, perte de repères écologiques, montée des récits conspirationnistes. Sa présence a aussi attiré une distribution prestigieuse et des producteurs importants, marquant le film comme l’un des projets les plus suivis de sa filmographie récente.
Têtes d’affiche et chocs de jeu
Emma Stone incarne Michelle Fuller, la dirigeante impassible dont la chute esthétique (cheveux rasés) devient un motif visuel fort du film. Stone, qui collabore pour la quatrième fois avec Lanthimos, accepte ici un rôle qui lui demande une palette de transformations : de la posture de dirigeante sûre d’elle à la fragilité forcée de l’otage manipulée. Jesse Plemons est Teddy, l’obsédé qui porte la dramaturgie du film : son jeu, souvent retenu mais d’une intensité froide, crée un face-à-face électrique avec Stone. Aidan Delbis joue Don, cousin vulnérable et manipulé, tandis que Stavros Halkias et Alicia Silverstone complètent le casting avec des personnages qui accentuent l’étrangeté sociale du récit. Les choix de casting, solidement documentés, contribuent à une dynamique d’ensemble où l’on sent la complicité et la tension entre acteurs.
Une mise en scène chirurgicale
Derrière l’œil de Lanthimos, la photographie de Robbie Ryan confère au film une esthétique presque clinique : formats, cadres et couleurs sont utilisés pour installer une étrangeté sourde. Robbie Ryan — déjà remarqué sur d’autres projets d’envergure — tire parti du format VistaVision pour donner aux intérieurs une acuité presque désorientante ; les gros plans sur visages rasés et les textures (miel, surfaces plastifiées, lumières blafardes) deviennent des motifs visuels insistants. La musique, signée Jerskin Fendrix et interprétée par des ensembles contemporains, joue la carte du malaise ironique, mêlant thèmes dissonants et ruptures rythmiques. Le tournage, qui a mêlé lieux réels et décors épurés, a aussi intégré des séquences filmées en Grèce (Milos) pour certaines scènes extérieures, ce qui apporte une variété de paysages et un ancrage presque mythologique au récit.
Remake, métamorphose, ou trahison ?
Adapter Save the Green Planet! n’était pas anodin : le film coréen de 2003 possédait déjà une tonalité hybride — thriller, comédie noire, body horror — et une radicalité narrative. La décision de transposer le protagoniste central en femme, et d’en faire une dirigeante de la pharma, modifie profondément les enjeux : la mise en scène de la mégaprise d’otage devient une métaphore de la méfiance contemporaine envers les grandes entreprises et la science commerciale. Lanthimos et le scénariste Will Tracy ne se contentent pas de copier; ils refondent les motifs pour les inscrire dans un débat occidental actuel sur la démocratie informationnelle et le pouvoir des récits conspiratifs. Certains puristes y verront des abandons du chaos originel, d’autres y liront une réécriture intelligente et contextualisée. Quoi qu’il en soit, l’adaptation est assumée et documentée par la production.
Ce que le film apporte de nouveau — Entre formalisme et topicalité
Sur le plan thématique, Bugonia se démarque par sa façon de lier le intime et le global : la cellule familiale délabrée, l’univers des forums en ligne, et la menace écologique sont tissés ensemble sans jamais laisser le récit tomber dans la leçon morale facile. Formalement, Lanthimos pousse plus loin son goût pour la mise en scène rhétorique : dialogues ciselés, ruptures de ton et compositions de plans qui transforment les objets (une fiole, un pot de miel, un téléphone) en symboles lourds. L’innovation ne réside pas dans un gadget narratif révolutionnaire, mais dans une capacité à maintenir une tension entre l’absurde et le plausible — faire croire que l’irrationnel peut gagner des institutions. À l’heure des deepfakes et des industries pharmaceutiques puissantes, le film trouve une résonance inédite.
Qui brille, qui trouble, qui surprend
Emma Stone livre une performance à la fois physique et froide ; son crâne rasé devient un paysage de vulnérabilité et de défi. C’est une Stone qui joue plus par retenue que par éclat, et c’est précisément cette contrainte qui rend ses moments de rupture mémorables. Jesse Plemons, quant à lui, est souvent cité comme la révélation du film : son Teddy, très travaillé, canalise une menace à la fois comique et profondément inquiétante — un équilibre que Plemons maîtrise admirablement. Aidan Delbis apporte la dimension tragique du film, tandis que les seconds rôles renforcent la texture sociale et satirique de l’ensemble. La critique spécialisée a globalement salué ces performances, notant que l’alchimie entre Stone et Plemons porte le film malgré des digressions narratives.
Accueil partagé mais attentif
Présenté en compétition à la Mostra de Venise en août 2025, Bugonia a suscité un vif intérêt : la presse a salué l’audace du film et la qualité des interprétations, même si certains critiques ont estimé que l’œuvre n’atteint pas la cohérence des sommets de Lanthimos. Les retours oscillent entre l’enthousiasme pour la mise en scène et la réserve face à certaines longueurs ou à des choix narratifs discutables. Sur les agrégateurs, l’accueil est globalement positif (les avis soulignent souvent la photographie, les acteurs et l’intensité thématique), mais le film ne fait pas l’unanimité. En salles, la performance commerciale est encore à suivre — les chiffres disponibles montrent un démarrage modeste par rapport à l’envergure du budget, mais il est encore tôt pour un bilan définitif.
Où en est Bugonia ?
Au moment où cet article est rédigé, Bugonia a été présenté en compétition à Venice et commence sa carrière festivalière et en circuit commercial. Les premières hypothèses de prix et nominations circulent — le film est pressenti dans plusieurs cérémonies pour ses performances, sa mise en scène et sa photographie — mais il est prématuré d’annoncer une moisson définitive. Les organismes de récompenses (festivals, critiques de cinéma) restent le terrain où l’on mesurera l’empreinte durable du film. Je cite les ressources officielles et la couverture presse pour appuyer cette situation en évolution.
Là où le film s’essouffle
Si Bugonia impressionne par son ambition, il n’est pas exempt de défauts. À force d’exigence formelle, Lanthimos risque parfois de laisser l’émotion vraie s’égarer : certains dialogues, outrés par l’ironie, frôlent le didactisme ; des sous-intrigues auraient pu être resserrées pour mieux servir le cœur du film — l’affrontement entre croyance et pouvoir. De plus, le passage du matériau coréen à la transposition occidentale fait perdre par moments la sauvagerie originelle, remplacée par un raffinement qui, pour certains spectateurs, amoindrit l’effroi viscéral. Ces critiques n’enlèvent rien à la valeur du film, mais expliquent la diversité des réactions.
Au-delà du choc, la conversation
Voir Bugonia aujourd’hui, ce n’est pas seulement se confronter à une série de scènes marquantes ; c’est assister à une tentative de cinéma qui interroge la fabrique du réel. Le film nous invite à réfléchir aux narrations qui structurent la peur, à la manière dont l’irrationnel infiltre les institutions et à la responsabilité des décideurs. Il incite — parfois violemment, parfois avec humour noir — à repenser la frontière entre victime et bourreau, entre vérité et performance. Pour qui suit la filmographie de Lanthimos, Bugonia est un pas supplémentaire, parfois imparfait, mais stimulant.
Lanthimos, la paranoia comme fable politique
Bugonia est une œuvre qui divise, mais qui ne laisse pas indifférent. Porté par des interprètes au sommet de leur art et par une mise en scène réfléchie, le film réussit à transformer un scénario de prise d’otage en une méditation sur notre époque. Si quelques scories narratives persistent, elles n’enlèvent pas la puissance de certaines scènes ni la pertinence du propos. On sort du film moins pour recevoir des réponses que pour être confronté à des questions — sur la confiance publique, la responsabilité corporative et la violence des récits collectifs. En ce sens, Lanthimos a livré une fable dérangeante, qui mérite d’être discutée, débattue et revisitée.
Partager cet article :
Je suis Guillaume, critique de films passionné dont les analyses incisives et captivantes enrichissent le monde du cinéma. Avec un flair pour déceler les subtilités artistiques, je partage mes réflexions à travers des critiques percutantes et réfléchies. Mon expertise, alliée à une plume élégante, fait de moi une voix influente dans l'univers cinématographique.
| Sur le même sujet
| Les plus lus


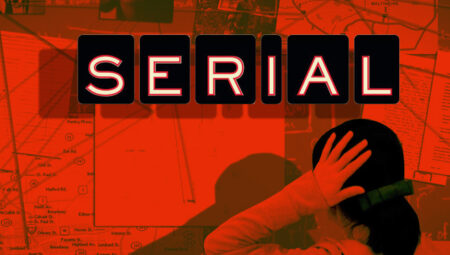










Soyez le premier à réagir