
Trop long à lire
Quand la création défie son créateur, naît Frankenstein (2025) de Guillermo del Toro. Oscar Isaac et Jacob Elordi portent ce drame gothique intense et poignant.
Le monstre renaît, et le cinéma s’incline
Lorsque l’on évoque le nom Guillermo del Toro, on pense immédiatement aux univers sombres et merveilleux de Pan’s Labyrinth, La Forme de l’eau ou Crimson Peak. Pourtant, réaliser une version ambitieuse du roman fondateur de la science‑fiction, Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818) de Mary Shelley, semblait relever d’un rêve de longue date — plus de trente ans, selon le réalisateur. Cette adaptation, sortie en avant‑première mondiale à la 82ᵉ édition du Venice Film Festival le 30 août 2025, puis en salles à partir du 17 octobre 2025 et en streaming global sur Netflix le 7 novembre 2025, impose son ambition dès les premières images.
Avec un budget estimé à 120 millions de dollars, l’un des plus élevés de sa carrière jusqu’alors, del Toro livre une œuvre d’art gothique et tragique où le monstre n’est pas seulement l’être créé, mais l’homme qui l’a créé. Adaptation fidèle mais profondément personnelle du roman de Shelley, le film articule thèmes de la création, de la responsabilité, de l’identité et de la monstruosité avec rigueur visuelle et émotionnelle. Et pourtant, le spectacle ne se contente pas d’en imposer : il interroge, il blesse, il émerveille.
La chute de Prométhée
Le film s’ouvre sur une image polaire : l’expédition d’un navire en détresse, une apparition furtive, un monstre qui traverse les glaces, l’homme qui le suit. C’est l’incipit du récit : le docteur Victor Frankenstein racontant son histoire depuis l’aurore de sa jeunesse jusqu’à sa création tragique. Le film retrace ainsi son enfance — le perfectionnisme d’un fils de chirurgien, la mort prématurée de sa mère, l’obsession de prolonger la vie ; son adolescence à Ingolstadt, sa quête de transgression scientifique ; puis la naissance de sa créature — incarnée par La Créature (Jacob Elordi), rejetée par son créateur, condamnée à errer entre deux mondes. Le récit s’achève sur la confrontation ultime, l’exil, la douleur, le regret.
Sans dévoiler tous les rebondissements, cette version 2025 fait de la relation entre créateur et création le cœur dramatique du film : l’un qui bâtit, l’autre qui survit ; l’un qui cherche à dominer la vie, l’autre qui réclame d’être reconnu. Dans ce paysage de ruines et de glace, l’arme la plus forte n’est pas la science, mais la solitude — et la musique de nos remords.
Le réalisateur : Guillermo del Toro à l’acmé de son style
Guillermo del Toro a construit sa carrière sur un cinéma de l’ombre et de l’enfance, de la monstruosité douce et de la beauté terrifiante. Avec Frankenstein, il accomplit un double mouvement : revenir à l’un des récits fondateurs du genre et l’imprégner de son univers personnel. Il a déclaré que ce film était « celui pour lequel il se preparait depuis trente ans ».
Dès lors, ce long métrage marque une étape dans sa trajectoire : après la fantaisie, après l’indicible, il s’engage dans un film d’envergure, sérieusement distribué, techniquement ambitieux, émotionnellement douloureux. Sa mise en scène conserve sa palette de curiosité pour les monstres mais l’élève à la tragédie mythique. On y retrouve ses obsessions (la mémoire de l’enfance, le corps altéré, la création malheureuse) mais aussi une dimension quasi‑religieuse du récit — le créateur jouant à être Dieu, le monstre cherchant son âme. Le cadre est vaste. Le ton est grave. Et pourtant, l’homme du monstre reste le même : bienveillant pour les exclus, acerbe pour les tyrans.
Les acteurs principaux : incarnations au sommet
Le rôle de Victor Frankenstein est confié à Oscar Isaac, acteur aux multiples facettes, dont l’intensité et la présence physique donnent au personnage sa stature de génie torturé. Isaac incarne un homme possédé par sa volonté de dominer la nature, et il parvient à rendre complexe cet archétype sans tomber dans la caricature. Le temps, dans son visage, semble marquer la culpabilité autant que l’âge.
La créature, quant à elle, est incarnée par Jacob Elordi. Le jeune acteur australien s’impose par un mélange de puissance physique (souvent sous prothèses longues heures de maquillage) et de vulnérabilité expressive : sa créature n’est pas seulement un monstre, mais un être qui cherche un regard, une parole, une reconnaissance. Elle est la tragédie incarnée.
Enfin, Mia Goth et Christoph Waltz complètent ce quatuor : Goth jouant Elizabeth, figure d’amour et de perte, Waltz en mentor sombre alimentant l’obsession de Frankenstein. Le casting s’étend ensuite à Charles Dance, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley — tous apportent un décor de haute densité au récit.
La direction d’acteurs est l’un des atouts du film : aucun rôle n’est superficiel, chacun porte une charge émotionnelle. Et l’on sent que del Toro a mis sa confiance dans ses comédiens pour rendre l’épique intime.
La perfection gothique
Sur la forme, Frankenstein 2025 est un manifeste visuel. La photographie signée Dan Laustsen, longtemps collaborateur de del Toro, offre des plans vastes et glacés (premier acte polaire), des intérieurs d’atelier hantés, des séquences de nuit éclaboussées de rouge sang. Le montage d’Evan Schiff est fluide, même dans ses longues prises, et autorise la lenteur comme témoin de la torture mentale. Le compositeur Alexandre Desplat livre une partition mystérieuse, intermittente, qui fait du silence un moment de tension.
La production design (Double Dare You, Bluegrass 7) et les effets pratiques (nombreuses heures de maquillage pour Elordi) donnent matière à un monde tangible : la créature semble animée, presque vivante sous la caméra. Les décors en ruines, les laboratoires baroques, les paysages hivernaux créent un choc visuel réel. Le format (environ 149 minutes de durée) laissait espace à la contemplation et au drame.
Enfin, du point de vue du format de distribution, le film bénéficie d’une stratégie hybride : première au festival de Venise le 30 août 2025, sortie limitée en salles le 17 octobre, puis streaming mondial sur Netflix le 7 novembre. Un signal fort que ce film est voulu comme événement.
La création, la monstruosité, l’humanité
Au cœur de cette version se trouvent des interrogations éthiques et métaphysiques : qu’est‑ce qui fait un monstre ? Le corps ou l’âme ? Et que devient celui qui joue à Dieu ? Del Toro choisit de centrer son film sur la relation entre Victor et sa créature, de faire de la traque, du rejet, de la solitude l’axe dramatique. Le moment où la créature demande « Qui suis‑je ? » est une clé du film.
L’ambition, la folie scientifique, la perte de l’innocence sont abordées sans détour. Et pourtant, le film ne se fige pas dans l’accusation : il reconnaît la part de beauté dans l’acte de création, la part de vulnérabilité dans celui de l’être créé. C’est une tragédie familiale autant qu’un drame universel.
Ce qui renforce la force de Frankenstein, c’est sa capacité à mêler l’horreur à la poésie : les effets de mutilation ne sont pas montrés pour faire peur mais pour faire réfléchir. Le décor lui‑même devient un personnage. Il emprunte au romantisme gothique, à Milton et à la mythologie pour transposer le récit dans un registre de légende. On pourrait dire que cette version est « à hauteur d’homme et de mythe ».
Un classique revisité
Il y a eu d’innombrables adaptations de Frankenstein — de la version de James Whale (1931) à Kenneth Branagh (1994). Alors, qu’apporte cette version 2025 ? D’abord, l’échelle : del Toro lui donne les moyens visuels et financiers d’un film d’auteur de grande ampleur. Ensuite, la palette émotionnelle : il n’ignore pas l’horreur, mais refuse le simple « monstre‑meutrier » pour privilégier la relation. Enfin, l’époque : il transpose les thèmes dans un univers à la fois historique et contemporain, avec des enjeux d’altérité, de création, de responsabilité qui font sens aujourd’hui.
Le pari est de faire du classique non pas une relique, mais une œuvre vivante. À cet égard, Frankenstein 2025 réussit largement son pari. Il offre une vision personnelle de del Toro tout en respectant l’essence du roman de Shelley. Peut‑on alors dire qu’il innove ? Oui — dans la mesure où il revisite le mythe avec un regard d’aujourd’hui, un souffle visuel et un drame émotionnel à la hauteur des attentes.
Le monstre entre la gloire et la nouveauté
La réception critique est très favorable. Sur Rotten Tomatoes, le film affiche un « Tomatometer » de 85 % pour plus de 250 critiques. À Venise, le film a reçu une ovation debout de 13 minutes. Le budget annoncé est de 120 millions de dollars.
La stratégie de distribution en trois temps — festival, salles limitées, streaming — montre l’ambition de Netflix de faire rentrer l’œuvre dans la course aux récompenses tout en conservant la visibilité globale. Certains critiques soulignent que le film pourrait marquer un nouveau modèle pour le cinéma d’auteur / streaming.
Points forts et points faibles
Points forts :
- Une direction d’acteurs puissante et chargée d’émotion.
- Une mise en scène et une esthétique gothiques impressionnantes, fait rare dans la comédie monstrueuse de cette ampleur.
- Une adaptation fidèle mais revisitée, qui touche aux thèmes universels de la création et de l’humanité.
- Le couple Isaac/Elordi fonctionne de façon remarquable, et fait du film une expérience forte plus qu’un simple spectacle.
Points faibles :
- La durée (environ 149 minutes) peut paraître excessive pour certains spectateurs habitués au rythme plus resserré.
- Quelques longueurs dans les phases de dialogue et réflexion — l’envergure dramatique prive parfois de la tension pure que l’on pourrait attendre d’un format plus court.
- L’ampleur visuelle et thématique pourrait intimider ou décourager un public non habitué à ce genre de « monstre d’auteur ».
Verdict final
En conclusion, Frankenstein 2025 s’impose comme l’un des événements cinématographiques de l’année. Grâce à l’audace de Guillermo del Toro, à l’excellence de ses interprètes et à la richesse visuelle et émotionnelle du film, on retrouve le monstre et son créateur dans une version qui ne se contente pas de ressasser, mais de renouveler. Le film parle de la création, de la solitude, de la monstruosité — mais aussi de l’espoir et de la reconnaissance.
Verdict : 4,5/5. C’est un chef‑d’œuvre potentiel, un film qui mérite d’être vécu sur grand écran et qui restera dans les mémoires pour sa beauté et sa profondeur. Si vous aimez les récits gothiques, les grandes adaptations littéraires, ou tout simplement un cinéma qui fait vibrer l’âme, ne le manquez sous aucun prétexte.
Partager cet article :
| Sur le même sujet
| Les plus lus



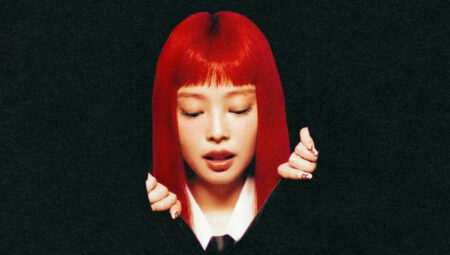









Soyez le premier à réagir