
Plongeons sans gilet de sauvetage : Murder Company est un film de guerre sorti en 2024 qui veut raconter une mission suicide derrière les lignes ennemies au moment du débarquement en Normandie. Le film est signé Shane Dax Taylor ; il réunit un plateau composé de William Moseley, Kelsey Grammer, Pooch Hall, Joe Anderson et Gilles Marini, et a été distribué en salles limitées puis en VOD l’été 2024. Sur le papier, on tient un petit soldat du genre : cadre historique connu, cible moralement lisible et promesse d’action condensée en moins de cent minutes.
Plongée dans l’intrigue
L’histoire se situe à la veille — ou dans les heures — du débarquement. Un groupe de parachutistes américains se voit confier une mission clandestine : récupérer un opératif de la Résistance française et le ramener derrière les lignes allemandes afin d’éliminer un officier SS de haut rang. Le récit suit leur progression entre embuscades, petits combats et moments de fraternité sous la pluie d’obus. Le film joue sur l’urgence, la débrouillardise et l’esprit d’équipe, mais aussi sur un certain bricolage dramatique qui rappelle que la vraisemblance historique n’est jamais la priorité numéro un de la production.
Shane Dax Taylor, du téléfilm à l’effort de guerre
Shane Dax Taylor n’est pas un nom du panthéon des génies du Septième Art, mais il a déjà l’habitude de mener de petits projets avec ambition. Son film précédent et sa trajectoire montrent un intérêt pour des récits populaires, tournés vite et conçus pour l’exploitation VOD/plateformes. Ici, Taylor s’en tient à une mise en scène fonctionnelle : plans lisibles, montage nerveux et focalisation sur l’action plutôt que sur de longues obsessions thématiques. Le geste est celui d’un artisan qui respecte les codes du genre et qui, parfois, les porte au ras du sol pour économiser minutes et effets. Si l’on attendait une relecture novatrice du film de guerre, on en est loin ; si l’on veut un film qui va droit au but, on est dans la cible.
Les visages sur le pont
William Moseley campe le sergent Jim Southern, présence jeune et volontaire qui incarne la bravoure physique du récit. Kelsey Grammer, surprenant choix de tête d’affiche pour un film de cette envergure, apparaît en général au commandement — une présence gravée dans l’outrance télévisuelle qu’il sait livrer même dans un rôle secondaire. Pooch Hall offre la chaleur nécessaire au rôle du soldat frère d’armes tandis que Joe Anderson et Gilles Marini complètent le groupe avec des tempéraments plus nerveux et plus européens quand il le faut. Le casting joue la carte d’une efficacité de plateau : des types crédibles avec des armes et des bottes, prêts à remplir les cases que le scénario leur alloue.
Sofia, studios et poussière de budget
Plutôt que d’aller s’installer en Normandie, la production a majoritairement posé ses caméras à Sofia, en Bulgarie, un choix devenu classique pour les petites productions historiques à la recherche de décors et de coûts maîtrisés. Les repères sont donc mixtes : plateaux transformés en hameaux français, bosquets reconstitués et effets pyrotechniques mesurés. L’économie de moyens est visible à l’écran — souvent à l’avantage de la lisibilité des scènes d’action, parfois au détriment d’un sentiment d’échelle qui ferait mieux pour un film se réclamant d’un grand événement historique. Pour résumer, on sent la production qui a priorisé l’authenticité de costume et l’efficacité de tournage sur la reconstitution grand luxe.
Soigner la machine ? Parfois.
Murder Company n’invente pas le film de guerre ; il recycle, réassortit et sert chaud ce que le genre connaît depuis des décennies : courage, trahison, portes qui claquent, et frères d’armes qui se regardent dans la nuit. Là où le film trouve sa justification, c’est dans la manière pragmatique dont il orchestre des séquences courtes et sanglantes et dans la volonté de raconter une petite histoire humaine au sein d’un grand conflit. Les critiques professionnels l’ont résumé de manière similaire : une proposition de genre qui fonctionne comme elle veut — utile, parfois propre, rarement mémorable.
Entre muscles, récitatifs et quelques moments de grâce
Sur la question « est-ce que les acteurs sont bons ? », la réponse varie selon les attentes. William Moseley tient son personnage avec franchise ; il est plausible en leader de poche. Pooch Hall reçoit quelques séquences où il peut vraiment exister, et il les rend justes. Kelsey Grammer, lui, est un peu l’attraction du soir : présence assurée mais rôle limité, qui frustre ceux qui auraient aimé le voir emporter le film. Les seconds rôles remplissent leurs fonctions. Globalement, la distribution fait ce qu’on lui demande : donner du corps à des dialogues parfois convenus et porter les moments d’action. Les critiques ont noté à la fois l’engagement physique — louable pour une production modeste — et la faiblesse d’écriture qui ne permet pas toujours aux comédiens d’atteindre des reliefs plus intéressants.
Quand la gravité prend un faux pli comique
Et maintenant, la partie que vous avez demandée : l’ironie et le burlesque. Murder Company n’est pas une comédie, mais il y a des instants où la mise en scène, les dialogues ou la synchronisation dramatique produisent un effet presque clownesque. Un plan heroïque trop long, une réplique solennelle qui tombe sur un bruit de plateau, une explosion qui arrive au mauvais moment… Ces accidents de fabrication deviennent des espaces de rire nerveux. Certains observateurs ont même qualifié la bande-annonce de « cheap and cheesy » (bon, pas exactement un prix de finesse), et l’ensemble possède ce charme un peu B-movie qui transforme l’effort en spectacle bondissant quand on accepte d’y aller avec un sourire en coin. Bref : on pleure parfois pour de bonnes raisons, on rit parfois pour de meilleures.
Les débats historiques et la « véracité » : storytelling ou réécriture ?
Le film revendique une inspiration « basée sur des faits » dans certains communiqués promotionnels, mais la lecture attentive montre plutôt un détour par l’« alternate history » et par la dramatisation libre du réel. Les puristes de l’Histoire peuvent s’agacer : dates, tactiques, et contextes sont utilitaires, au service de la tension et non de la leçon. Ce choix narratif est compréhensible pour une production qui vise l’efficacité dramatique plutôt que la démonstration érudite. En clair : ce n’est pas un manuel, c’est un film. Et comme pour tout film qui s’empare d’un passé sanglant, il faut accepter la part de fiction.
Bonne comédie involontaire ou casse-tête engageant ?
Adoptons une posture honnête et narquoise : Murder Company offre des séquences d’action qui tiennent la route quand le budget le permet, et des scènes de camaraderie qui rappellent les vieux films de troupe. Les moments qui basculent dans le burlesque (volontairement ou non) lui donnent, paradoxalement, une personnalité. Si vous aimez les films sérieux qui s’autodérident sans l’avouer, vous aurez du plaisir. Si vous vénérez les reconstitutions historiques chirurgicales, attendez-vous à pester parfois. Le film n’est ni grandiose ni honteux : il est honnête dans ses limites et parfois même drôle quand il ne le veut pas.
A qui offrir la place ?
Si l’on doit trancher sans remords : Murder Company est un petit film de guerre honnête, imparfait et ponctuellement réjouissant. Regardez-le si vous aimez les récits de mission express, l’action serrée et les effets B-movie qui percent sous la surface sérieuse. Évitez-le si vous cherchez un film historique qui vous instruira ou si vous désirez une esthétique de blockbuster. Prenez-le comme un plat simple mais correctement assaisonné — et apportez une serviette, on ne sait jamais si la scène finale vous fera rire ou pleurer.
Partager cet article :
| Sur le même sujet
| Les plus lus


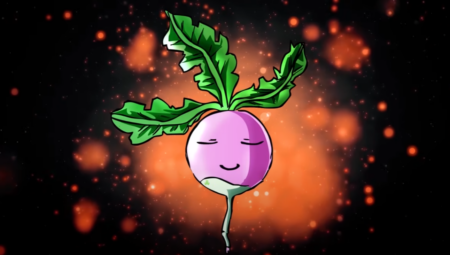










Soyez le premier à réagir