
Quand une série culte infiltre le cinéma
Transposer une série-culte d’espionnage au cinéma est une opération à haut risque. Il faut conserver l’ADN qui a fait vibrer les fans tout en musclant l’ampleur, la mise en scène et l’émotion pour justifier le grand écran. Sorti au Royaume-Uni le 8 mai 2015 — et rebaptisé MI-5 pour sa sortie américaine — Spooks: The Greater Good relève cet exercice d’équilibriste sans s’y casser les dents. Dirigé par Bharat Nalluri, l’un des architectes originels de la série, le film réunit l’indéboulonnable Peter Firth dans la peau de Harry Pearce et donne à Kit Harington le rôle d’un agent déchu rappelé à la rescousse, avec à leurs côtés Jennifer Ehle, Elyes Gabel, Lara Pulver et Tim McInnerny. C’est un thriller sec, rapide, discipliné, qui joue la carte du réalisme urbain et de la géopolitique contemporaine plutôt que celle du spectaculaire outrancier. Mais cette efficacité a un prix : celui d’un horizon formel et thématique qui dépasse rarement celui d’un épisode de luxe. (Faits vérifiés : réalisation, distribution, titre US et date de sortie, générique principal.)
Une taupe, un fantôme et Londres sous pression
L’ouverture est un cauchemar de service secrets : lors d’un transfert « routine », le terroriste Adem Qasim s’évade en plein Londres. La CIA veut une tête, la presse rugit, et Harry Pearce, patron de l’anti-terrorisme, simule sa propre mort en se jetant du pont de Lambeth. Dans ce jeu de dupes, Will Holloway, ex-protégé de Pearce devenu électron libre, est rappelé pour le retrouver et, si possible, colmater l’hémorragie au sein de l’agence. Entre deals inavouables, trahisons internes et pressions politiques visant à « externaliser » une partie de l’appareil de renseignement britannique, le film déroule une mécanique où la question n’est pas seulement d’empêcher un attentat, mais de savoir jusqu’où l’on peut salir ses mains pour sauver la maison. Le récit garde l’esprit Spooks : intrigues multiples, retournements secs, dialogues à couteaux tirés et géographie ultra-contemporaine de la surveillance.
Bharat Nalluri, du pilote télé à l’opération cinéma
Revenir à Spooks dix ans après avoir défini son langage visuel à la télévision, c’est l’atout-maître de Bharat Nalluri. Son parcours explique beaucoup du ton du film. Piloteur d’univers (il a lancé Spooks et dirigé des épisodes clés de Hustle et Life on Mars), Nalluri a aussi un pied solide au cinéma avec Miss Pettigrew Lives for a Day et, plus tard, The Man Who Invented Christmas. Ce profil hybride — sens de l’efficacité télévisuelle et goût pour un rythme de long métrage — imprègne The Greater Good. Dans un entretien autour de la sortie, on mesure sa volonté de « transposer le template » de la série au format ciné : l’intrigue resserrée, une photographie métallisée, un montage qui privilégie la tension logistique et un Londres filmé comme une enceinte stratégique. (Parcours et propos du réalisateur vérifiés.)
Salle des machines
Le film a été conçu comme une montée en gamme réaliste : privilégier les décors naturels et les axes urbains moins « postcards » que « points névralgiques ». La production s’est appuyée sur des tournages à Londres, Berlin, Moscou, l’île de Man et aux studios de Pinewood, avec un investissement régional qui a permis de capturer un prologue d’ampleur à Coventry — la séquence d’ouverture étant décrite par les financeurs comme l’un des plus gros set-pieces du projet. Cette approche, si elle n’a rien de révolutionnaire à l’ère du cinéma d’action « glocal », offre au film une surface quasi documentaire : on y reconnaît Lambeth Bridge (d’où Pearce « disparaît »), les abords de Thames House (siège réel du MI5, utilisé en extérieur), Gloucester Road, le Barbican, des rues et toits du West End… autant de lieux qui donnent aux courses-poursuites et aux filatures un poids géographique. La photographie d’Hubert Taczanowski, toute en gris acier et bleus froids, resserre l’espace sur les visages et les couloirs ; la musique de Dominic Lewis, nerveuse sans être envahissante, colle au tempo du montage. (Lieux, choix de décors et tournage confirmés.)
Qui fait quoi, et comment ça joue
Peter Firth, d’abord. Sa présence est l’axe moral du film : laconique, opaque, presque ascétique, il tient Harry Pearce comme un officier usé par vingt ans de compromis mais incapable d’abandonner sa « famille ». Il joue en nuance, par micro-variations de regard, et son autorité fait levier sur tout le récit. À ses côtés, Kit Harington doit composer avec un archétype — l’agent « recruté malgré lui », partagé entre rancœur et loyauté — mais il trouve une physicalité crédible, plus urbaine que bourrine, que son image Game of Thrones ne laissait pas forcément présager. Le duo fonctionne : ce n’est pas un buddy movie, plutôt un partenariat inconfortable nourri par l’histoire. Jennifer Ehle, en haute fonctionnaire qui pense le renseignement en termes d’architecture et de coûts politiques, apporte un sang-froid glacial. Elyes Gabel, dans le rôle d’Adem Qasim, compose un antagoniste convaincant : charisme et menace y priment sur l’idéologie, ce qui sert le thème de la manipulation. Le retour de visages familiers de la série — Lara Pulver, Tim McInnerny, Hugh Simon, Geoffrey Streatfeild — ancre le long métrage dans la continuité du canon tout en élargissant légèrement l’échiquier. (Distribution et rôles vérifiés.)
Le choix du terrain plutôt que du spectacle
Nalluri refuse la démesure numérique et fait confiance à la topographie. On sent des caméras mobiles, positionnées au ras du flux londonien, dans des gares, sur des ponts, dans des parkings et des immeubles administratifs. Les poursuites s’écrivent moins en « setpieces » qu’en diagonales : on coupe par une passerelle, on file à travers un hall, on bifurque dans un escalier de service. Ce minimalisme — relatif — donne parfois l’impression d’un « épisode XXL » : l’action est sèche, mais rarement emphatique. À l’écran, l’outil principal reste la tension : deux personnages qui marchent vite en parlant très bas dans une artère bondée, un regard dans une vitre, un alignement de portables sur une table, l’ombre d’un drone qu’on ne verra pas. On est là dans un parti pris cohérent : Spooks n’a jamais été une franchise de gadgets, mais un théâtre d’opérations à hauteur d’hommes.
Ce que le film ose (et ce qu’il n’ose pas)
Oui, en partie. Le long métrage ose une critique frontale des dépendances transatlantiques en renseignement, la tentation de « privatiser » des pans d’État, et le flou moral d’une lutte antiterroriste menée à flux tendu. Ces sujets irriguent la série, mais le film les cadre avec l’actualité du milieu des années 2010 : rapports de force CIA/MI5, optimisation budgétaire, panique médiatique. L’autre nouveauté tient à l’ampleur donnée à la ville : Londres n’est pas un décor, c’est un système nerveux que la mise en scène cartographie. En revanche, le scénario ne fracture pas la formule. Dans sa structure (évasion, enquête avec exfiltration, chasse à la taupe, double jeu final), The Greater Good reste un récit de procédure qui s’achève de manière très Spooks — c’est-à-dire dans l’ambiguïté des coups gagnants qui coûtent cher. On pouvait espérer une prise de risque thématique plus âpre, ou une reconfiguration plus radicale des personnages.
Un film d’espionnage version « hard-reset »
Sur le plan formel, l’innovation est mesurée. L’utilisation extensive de lieux réels et l’insistance sur les flux (caméras de surveillance, géolocalisation, interceptions) inscrivent le film dans une modernité discrète, plus proche d’un state thriller britannique que d’un blockbuster technoïde. Dans la logique de franchise, l’innovation consiste à « ouvrir » Spooks à un public qui ne connaît pas la série : exposition limpide, motivations basiques mais lisibles, arcs émotionnels contenus. On sent aussi l’intention de tester une nouvelle génération de personnages — Harington en « héritier » potentiel — sans renier la fidélité des fans au personnage de Pearce. Mais côté langage cinéma, on reste dans un classicisme assumé : cadrages fonctionnels, montage nerveux, partitions musicales au service de la tension, et photographie réfléchie mais non ostentatoire. La modernité, ici, n’est pas un effet de style ; c’est une discipline.
Les acteurs sont-ils bons ? Oui, et c’est la mise en scène qui les tient
Firth, on l’a dit, est la pierre angulaire. Sans grand discours, il incarne la mélancolie des espions : non pas la pose fatiguée, mais la fatigue comme condition d’existence. Harington, visage fermé, épaules tendues, fonctionne très bien dans l’action resserrée, moins dans la confession — mais le rôle ne l’y invite pas vraiment. Jennifer Ehle est impeccable de technicité : son personnage vit dans les clauses d’accords et les marges de manœuvre, et l’actrice imprime cette conscience froide à chaque plan. McInnerny et Pulver, en vétérans de la série, apportent une densité immédiate : une intonation, une posture, et l’on comprend l’historique. Quant à Elyes Gabel, il échappe au cliché du « méchant » monolithique par une économie de jeu qui fait ressortir la menace plus que l’idéologie. On peut regretter que certains seconds rôles — Hugh Simon, Geoffrey Streatfeild — soient réduits à une fonction narrative ; c’est la rançon d’un récit tendu.
Un sprint critique entre plaisir coupable et réserves
Côté critiques, l’accueil a oscillé entre divertissement « Bourne-lite » et efficacité sérieuse, jamais honteuse. Au Royaume-Uni, on a salué le rythme et le professionnalisme, tout en notant une intrigue « nonsense but fun » pour certains, ou « brisk, fans won’t be disappointed » pour d’autres. Sur l’agrégateur Rotten Tomatoes, le film affiche un score mitigé : pas un consensus négatif, mais le signe d’un divertissement efficace plus que marquant. En salle, la trajectoire est celle d’un spin-off britannique mid-budget : sortie UK au printemps, diffusion limitée aux États-Unis sous le titre MI-5 en décembre, et un cumul mondial modeste mais correct au regard d’un budget très contrôlé. (Contexte critique, score, sortie US et recettes vérifiés.)
Tournage, musique, technique : quelques points saillants à ne pas manquer
Le choix d’Hubert Taczanowski à la photo et de Dominic Lewis à la musique contribue fortement à l’identité du film. Taczanowski, qui a l’œil pour les géométries froides et les lignes de fuite urbaines, fait de Londres une carte d’angles morts et de parois vitrées. Lewis, lui, calque ses accélérations sur la logique opérationnelle : plutôt que de surligner l’émotion, il active la pulsation des scènes d’infiltration et de filature. Les localisations, encore, sont déterminantes : Lambeth Bridge, Gloucester Road, le Barbican, des pans du West End, l’extérieur de Thames House — rarement exploité ainsi — ancrent les enjeux dans la réalité physique de la capitale. À Coventry, l’ouverture donne le ton : « l’action » s’exécute dans l’infrastructure civile, pas dans un no man’s land anonyme. Cette matérialité crée une tension « du quotidien » : le danger circule là où nous circulons. (Équipe technique, lieux et tournage confirmés.)
Pas de raz-de-marée, mais une note musicale remarquée
Spooks: The Greater Good n’a pas trusté les cérémonies internationales. On est loin d’un film à Oscars, et ce n’est pas son ambition. Pour autant, la partition de Dominic Lewis a attiré l’attention : le compositeur a figuré parmi les cinq nommés au « Discovery of the Year » des World Soundtrack Awards 2015, au côté d’autres émergents remarqués. C’est peu, mais c’est juste : la musique participe pleinement au « flow » d’opérations du film. (Nomination vérifiée sur la liste officielle WSA 2015.)
Ce que le film dit de la Grande-Bretagne de 2015
Comme souvent chez Spooks, le commentaire politique n’est jamais frontal, mais il sourd de partout. La défiance vis-à-vis d’une tutelle américaine perçue comme prédatrice, l’angoisse budgétaire des institutions, la porosité entre public et privé dans la sécurité, et la difficulté à penser la menace autrement que dans la réaction immédiate : c’est le paysage mental d’un Royaume-Uni post-Snowden, sous gouvernement conservateur, inquiet de ses frontières et de ses alliances. Le film a l’intelligence de faire de ces lignes de fracture des motivations dramatiques, non des thèses. À cet endroit, la retenue évite le prêche, mais elle bride aussi l’ambition : The Greater Good aurait pu — aurait dû — froisser davantage, poser une ou deux questions insolvables qui nous hantent après la projection.
Entre tradition state thriller et compétiteurs globaux
Mis à côté des machines hollywoodiennes (Mission: Impossible – Rogue Nation sort la même année) ou du « real-politics » bondien de l’époque (Spectre, 2015), Spooks paraît plus modeste, plus « logistique », presque artisanal. C’est sa faiblesse — on ne sort jamais la mâchoire décrochée — et sa force : l’impression que chaque séquence pourrait exister dans un service réellement saturé, avec des moyens comptés, une hiérarchie nerveuse, et la peur d’un faux pas politique. Cette texture est rare dans un cinéma d’espionnage souvent dominé par la surenchère. Là où d’autres films capitalisent sur la chorégraphie ou la mythologie, Nalluri capitalise sur l’organisation et le coût moral des décisions.
Où le film trébuche (et pourquoi ça n’empêche pas le plaisir)
Le principal écueil tient à la prévisibilité de la structure : un spectateur aguerri sentira assez vite où se logent les doubles jeux, qui trahira qui, qui finira sacrifié. Certains enjeux émotionnels — la relation Harry/Will, notamment — restent à l’état d’ébauche fonctionnelle. Enfin, le film confond parfois accélération et intensité : courir vite n’est pas toujours raconter plus fort. Cela dit, la cohérence interne, l’économie de moyens, la crédibilité des décors et la tenue d’acteurs maintiennent le plaisir du « procedural » de haute qualité. C’est exactement le film que son cahier des charges annonçait : pas moins, pas plus.
Mission accomplie, sans extraction héroïque
Spooks: The Greater Good remplit sa mission : offrir aux fans un prolongement grand écran qui respecte l’esprit de la série tout en profitant d’un terrain réel élargi, et proposer aux néophytes un thriller solide, respirant Londres et ses réseaux de pouvoir. Nalluri choisit la rigueur plutôt que la flamboyance, la topographie plutôt que la pyrotechnie. On peut rêver d’une suite plus audacieuse — sur le plan moral comme formel —, mais au jeu de l’infiltration, ce film-là mérite sa place dans le canon Spooks. Pour reprendre la logique du titre, le « plus grand bien » qu’il sert est celui d’un cinéma d’espionnage britannique qui, sans fracas, continue de croire que la vérité dramatique se niche dans un escalier de service, une liaison chiffrée, un regard à travers une vitre.
Partager cet article :
| Sur le même sujet
| Les plus lus


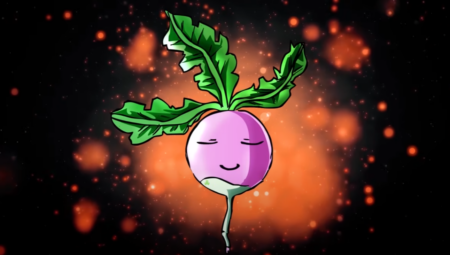









Soyez le premier à réagir