
Du bruit et de l’ombre, ou la dernière boîte hantée
Quand Bryan Bertino — réalisateur de The Strangers (2008) et The Dark and the Wicked (2020) — revient en 2025 avec Vicious, on s’attend à ce qu’il recommence à explorer les recoins sombres de l’âme, à filer la peur comme on tisse une toile invisible. Mais cette nuit-là, plutôt que de vous laisser sortir du cinéma tremblant, le film choisit de vous enfermer chez vous, sous vos couvertures, et de vous rendre à la fois voyeur et victime.
Vicious ne se contente pas de mettre en scène la peur ; il tente de la cristalliser dans un objet — une boîte — et dans le temps qui s’égrène, implacable. Le spectateur, en cela, est proche du personnage principal, pris dans une mécanique surnaturelle autant qu’intime. On attend du film un huis clos cauchemardesque, une épreuve psychologique, un théâtre de l’effroi. Bertino promet, avec Vicious, une danse entre réalité et illusion. Il livre… un quasi-miracle, avec ses ratés. C’est un film qui fait peur, oui — mais la peur est inégale, parfois magnifique, souvent frustrante.
La boîte, la boîte qui va ouvrir la nuit
Polly, jeune femme seule, vit dans une grande maison dont le silence semble déjà menaçant. On devine qu’elle traîne une fatigue existentielle. Un soir d’hiver, tard, quelqu’un frappe à sa porte : une vieille femme mystérieuse (Kathryn Hunter). Elle semble égarée, recherche une adresse, demande de l’aide.
Puis surgit l’horreur tranquille : elle n’est pas là pour seulement demander de l’aide, mais pour donner. Elle apporte une boîte noire, et un ultimatum : Polly va mourir cette nuit. Et pour espérer survivre, elle devra placer dans la boîte trois objets — l’un qu’elle honte, l’autre qu’elle déteste, l’autre qu’elle aime. L’énigme est à la fois simple et grotesque : comment choisir quand les frontières entre ce qu’on hait, ce qu’on aime, et ce dont on a besoin sont floues ?
À partir de ce moment, la vie de Polly devient un labyrinthe moral. Des appels de sa mère, des messages, des souvenirs d’un père peut-être mort, des visions ou hallucinations : tout se mêle. Ses névroses, ses regrets, ses peurs. Le surnaturel, s’il existe, est comme un filtre : il distord la mémoire, rend les voix incertaines, la réalité poreuse. Elle lutte contre le temps, contre l’angoisse, contre la boîte.
Sans dévoiler la fin : le film ne résout pas tout. Il préfère clore plusieurs fils narratifs sur une image forte, sur une promesse inachevée, sur la sensation que le cauchemar continue, même après le générique.
Bryan Bertino, le faiseur d’ombres
Bryan Bertino ne s’est pas perdu en route depuis ses débuts. The Strangers (2008) lui a donné un nom parmi ceux qui savent faire de la maison isolée un personnage, de la nuit une menace tangible. The Dark and the Wicked (2020) a confirmé qu’il aime regarder le désespoir, non pas comme spectacle brutal, mais comme paysage intérieur.
Avec Vicious, Bertino reprend ses obsessions : isolement, culpabilité, peur primitive. Mais il cherche aussi à pousser plus loin — à ménager non seulement des sursauts de peur, mais une montée de malaise existentiel. Il veut que l’horreur ne soit pas seulement visuelle, mais psychologique : ce qui ne se voit pas, ce que l’on tait, les blessures du passé, les secrets qu’on étouffe.
Le film montre son désir de jouer avec le temps — flashbacks, voix du passé, souvenirs douloureux — et avec le non-dit. Mais c’est aussi sa limite : parce que pour qu’un film de ce style fonctionne, il ne suffit pas de poser les éléments, il faut les connecter, donner assez pour que le spectateur ressente la terreur ET la compréhension. Ici, Bertino semble hésiter entre deux rôles : celui de manipulateur de frissons, ou de guide vers quelque chose de plus profond. Parfois, il change de jambes en montant l’escalier.
Dakota Fanning et les fantômes intérieurs
Au centre de Vicious trône Polly, incarnée par Dakota Fanning. C’est sa grande performance — presque toute seule dans la nuit, à parler à des voix, à affronter ses secrets, à hésiter entre la douleur et la peur. Fanning donne à Polly une fragilité concrète : ses hésitations, ses larmes, ses respirations haletantes, ses cernes, ses peurs — tout respire l’humain. Elle ne surjoue pas le désespoir, mais le fait palpiter.
Kathryn Hunter, dans le rôle de la vieille femme mystérieuse, est un contrepoint fascinant : peu présente, mais toujours menaçante, toujours liminale. Elle incarne l’énigme, l’objet catalyseur : sans elle, la boîte ne prendrait pas. Mary McCormack, Rachel Blanchard, Devyn Nekoda (par exemple la nièce Aly), complètent le tableau : un cercle de voix, souvenirs, interactions qui cristallisent les regrets et les peurs de Polly. Ces personnages secondaires ne sont pas toujours pleinement développés — parfois modèles ou symboles plutôt que personnalités — mais c’est en partie voulu : le film fait de Polly le centre gravitationnel de tout chaos.
Analyse technique et mise en scène : l’art de l’obscur lumineux
Photographie et mise en décor
Tristan Nyby, chef opérateur, met en lumière la maison comme un sanctuaire de l’inquiétude : grands couloirs, recoins sombres, fenêtres où l’on guette le dehors. L’intérieur et l’extérieur dialoguent : le calme apparent du jardin, la lumière tamisée, les ombres cisaillées dans les murs. Tout est à la fois familier — une maison de banlieue ou résidentielle — et anormalement froid.
Les décors intérieurs jouent sur le minimalisme : peu d’objets, mais choisis, lourds de signification (la boîte bien sûr, mais aussi les bouteilles de vin, les cigarettes, les photographies, les meubles usés). L’extérieur – Ottawa au printemps, gris, mouillé, silencieux – renforce la solitude.
Son et musique
La bande-son de Tom Schraeder, trop discrète parfois, apparaît dans les moments cruciaux. Le silence — ou l’absence de musique — pèse, quand ce qui pourrait être un moment apaisant est interrompu par le bruit d’une porte, un craquement, une respiration. Le montage sonore joue un rôle clé dans la tension. On note aussi l’usage de la voix off (ou en voix arrière-plan) pour cristalliser la mémoire et la culpabilité : appels téléphoniques, messages vocaux, souvenirs audibles mêlés au présent.
Montage, rythme et structure
Avec 98 minutes, le film ne s’embarrasse pas : il va droit vers ses moments de peur, mais le rythme est inégal. Le premier acte installe efficacement l’ambiance, les règles de la boîte, l’isolement. Le milieu du film tente de jouer sur la confusion, les hallucinations, les visions, mais parfois au prix de la cohérence. Le dernier acte, quant à lui, souffre d’une certaine fatigue dramatique : les révélations sont effleurées, les fils narratifs se croisent, mais sans toujours se résoudre. Le montage s’accélère, mais l’effet crispé laisse le spectateur parfois sur sa faim.
Ce que le noir nous dit
Identité, regret, mémoire
Le film est une exploration de ce qu’on porte en soi : les amours, les haines, les besoins, les manques. Polly est hantée, non seulement par la boîte, mais par ce qu’elle a fui, ce qu’elle a refusé. Les dialogues (souvent via téléphone, messages vocaux) avec sa mère, les souvenirs du passé, des regrets non dits : tout cela forme un palimpseste que l’objet surnaturel fait remonter.
Peurs matérielles et surnaturelles
Le surnaturel dans Vicious n’est pas un spectacle, mais un outil : il sert à rendre palpable l’invisible. La boîte devient métaphore : de la pandémie d’anxiété, de la culpabilité, de la dépression, du sentiment de ne plus contrôler sa vie. Mais le film hésite trop souvent à choisir : est-ce un film de fantômes ? Ou un thriller psychologique ? Ou une métaphore de nos monstres intérieurs ? Cette ambigüité est séduisante, mais finit par devenir diffuse.
La boîte comme rituel et piège moral
L’idée de devoir donner une chose que l’on aime, que l’on hait, que l’on besoin est puissante : elle force à regarder non pas ce que l’on possède, mais ce que l’on est. Ce sont ces choix — parfois absurdes, parfois douloureux — qui constituent le cœur du malaise. Bertino interroge ce que signifie “aimer” ou “détester” quand la frontière entre obligations sociales, culpabilités familiales, auto-critique est floue.
Violence, spectre du réel
Même quand l’horreur est visuelle (sang, mutilation, scènes gore), ce sont les blessures invisibles — culpabilité, maladie mentale, solitude — qui restent après le générique. Le film ne cherche pas la violence gratuite, mais un malaise prolongé. Voilà où il est le plus fort : dans les moments où, après un sursaut, le silence impose sa pression.
Quand le familier flirte avec le déjà-vu
Ce que Vicious apporte
- Le casting, en particulier la performance de Dakota Fanning, tient le film debout dans ses moments les plus intenses. Elle ramène de la crédibilité à l’angoisse, et incarne avec nuance une femme au bord du précipice.
- L’ambiance : la maison isolée, le décor résidentiel qui semble être le miroir brisé de Polly elle-même. C’est familier, mais bien exploité dans la durée.
- L’idée de la boîte, du rituel morbide, est un concept intéressant, propice aux métaphores. Le film pousse le spectateur à regarder ce qu’il refoule.
Limites visibles
- L’écriture, notamment des personnages secondaires : ils apparaissent souvent comme des voix, des fantômes plus que comme des figures pleinement incarnées. On manque de moments forts avec eux pour vraiment ressentir l’attachement ou la terreur.
- Le rythme : après une montée en puissance très bonne, Vicious rate un peu son virage final. On attend des rondes de tension plus soutenues, des ramifications plus claires. Parfois, c’est le vacarme (jump scares, cris, sons stridents) qui prend le pas sur la suggestion.
- Le manque de résolution : les spectateurs qui aiment les films d’horreur avec mystères bien fermés peuvent être frustrés, car plusieurs questions restent en suspens — la nature exacte de la boîte, l’étendue du surnaturel, la frontière entre ce qui est psychologique ou réel.
Réception & données critiques
Vicious a reçu un accueil mitigé :
- Sur Rotten Tomatoes, le film affiche environ 47 % de critiques positives, avec des avis qui louent la performance de Fanning mais critiquent la cohérence et la force de l’écriture.
- Common Sense Media signale un taux de violence élevé, des scènes graphiques, des images dérangeantes (amputations, vision de morts), et note que le film pourrait être trop intense pour un public non aguerri.
- RogerEbert.com souligne que si le film a une forte idée de départ et une atmosphère, il peine à maintenir le cap : trop de jump scare, trop d’incertitudes thématiques, une fin ouverte qui ne parvient pas à tout relier.
Côtés chiffres : pas de sortie cinéma majeure – Vicious a été retiré du calendrier des salles de Paramount, et a été publié directement en streaming via Paramount+ le 10 octobre 2025.
Verdict poétique
Vicious est comme une boîte fermée qu’on ne veut pas ouvrir — par peur, par curiosité, par un mélange des deux. Bryan Bertino tend la main pour nous faire regarder ce que l’on fuit : solitude, regret, peur de la mort, culpabilité. Dakota Fanning, dans la maison silencieuse, porte ce dilemme sur ses épaules : savoir ce qu’on doit donner, ce qu’on aime, ce qu’on hait.
Ce film ne sera pas parfait — il n’a pas la clarté, la maîtrise dramatique constante des meilleurs films de genre — mais il a quelque chose de sincère. Il ne cherche pas tant à vous surprendre qu’à vous déranger. Et c’est dans ces moments dérangeants que l’horreur atteint quelque chose de vrai.
Verdict final : Vicious est un huis clos surnaturel réussi, une épreuve sensorielle où la peur devient confession. Un film inégal, parfois confus, mais assez puissant pour hanter quelques nuits.
Partager cet article :
Je suis Claire, critique passionnée avec un regard acéré pour les détails artistiques. Mes critiques mêlent profondeur et élégance, offrant des perspectives uniques sur les médias. Avec une plume raffinée et une compréhension fine des œuvres, je m'efforce d'enrichir le dialogue et d'éclairer les spectateurs.
| Sur le même sujet
| Les plus lus

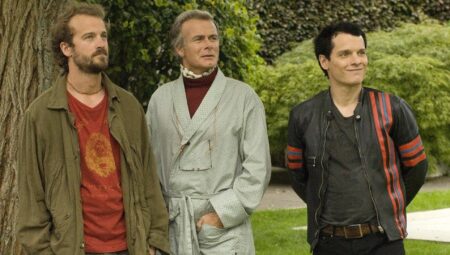











Soyez le premier à réagir