
Entrons directement dans la pièce qui se referme : Cube 2 : Hypercube est la suite officielle du film culte Cube (1997). Sorti en 2002, ce deuxième chapitre troque le décor rouillé et industriel du premier opus pour une version « high-tech » et mathématiquement tordue du labyrinthe — une série de pièces qui jouent non plus sur des pièges mécaniques mais sur la manipulation de l’espace, du temps et de la réalité elle-même. Le film est réalisé par Andrzej Sekuła, connu surtout pour son travail de directeur de la photographie sur des films majeurs, et réunit un casting international emmené par Kari Matchett et Geraint Wyn Davies. Si l’idée d’une « hypercube » promet la grandeur conceptuelle, l’exécution alterne entre moments de vraie tension et fulgurances techniques qui ont, hélas, pris un coup de vieux.
La mécanique du cauchemar
Huit inconnus se réveillent, comme dans le premier film, dans des pièces cubiques identiques — sauf que cette fois les lois physiques ne s’appliquent pas de la même manière d’une chambre à l’autre. Gravity inversée, dilatation temporelle, pièces qui se replient sur elles-mêmes : ce qui n’était qu’un piège physique devient un dispositif mathématique et ontologique. Peu à peu, les survivants réalisent qu’ils ont tous, d’une manière ou d’une autre, un lien avec la mystérieuse organisation Izon et que la « boîte » n’est peut-être qu’un prototype d’un procédé beaucoup plus inquiétant. La progression du film mêle enquête paranoïaque, claustrophobie et révélations qui remettent en question l’identité et la réalité.
Andrzej Sekuła aux manettes
Choisir Andrzej Sekuła pour réaliser la suite était un geste intéressant : photographe de formation et chef opérateur prestigieux — on lui doit, entre autres, les images de Reservoir Dogs et Pulp Fiction — Sekuła arrive sur Hypercube avec une culture visuelle forte. Sa carrière de directeur de la photographie l’a formé à composer des cadres tranchants et des textures lumineuses ; passer derrière la caméra pour signer la mise en scène d’un film aussi conceptuel était, sur le papier, une bonne idée. En pratique, on sent chez lui l’œil du chef opérateur : cadrages soignés, maîtrise des ambiances froides et désir d’imposer une esthétique high-tech. Mais diriger un film à énigme exige aussi une direction d’acteurs et un ajustement du scénario qui ne sont pas toujours parfaitement servis ici.
Les visages dans le cube
La distribution rassemble plusieurs comédiens canadiens et anglophones : Kari Matchett (Kate), Geraint Wyn Davies (Simon), Grace Lynn Kung (Sasha/Alex), Matthew Ferguson (Max), Neil Crone (Jerry) et d’autres figures secondaires qui complètent la troupe de la survie. Globalement, l’interprétation est l’un des points qui sauve le film : les acteurs savent tenir la respiration d’un huis clos mouvant et rendent crédible la panique progressive, la suspicion et l’effritement psychologique du groupe. Certaines performances — notamment celles de Matchett et Kung — prêtent à la fois sensibilité et nerf au récit, tandis que d’autres personnages sont malheureusement écrits de façon plus fonctionnelle que nuancée.
Un produit canadien
La production a essentiellement tourné au Canada, avec des prises de vues concentrées autour de Toronto et des plateaux intérieurs dédiés aux labyrinthes cubiques. Le film met largement à contribution les plateaux — décors impersonnels mais modulaires — et un important travail de post-production pour rendre les effets de distortions spatiales et temporelles. Le choix de lieux et la fabrication des salles fonctionnent quand il s’agit de créer une sensation d’unité froide ; en revanche, la modestie du budget se fait sentir dès que le film tente des effets visuels ambitieux : certaines incrustations 3D et CGI ont mal vieilli ou manquent de naturel.
Quelque chose de déjà vu
Sur le plan conceptuel, Hypercube a le mérite d’essayer d’élargir l’univers. Là où Cube jouait la carte du piège industriel et du mécanisme mortel, la suite explore l’idée d’un espace topologique où les règles ne sont plus celles qu’on connaît : la notion de tesseract (l’hypercube en quatre dimensions) introduit la possibilité de miroirs, de duplications et de temps qui se plient. C’est une idée séduisante — presque trop séduisante — car elle ouvre une infinité d’options narratives. Le problème tient à la gestion : transformer un concept scientifique élégamment inquiétant en images et en suspense n’est pas trivial, et Hypercube balance entre moments d’authentique étrangeté et explications technobabblées qui alourdissent parfois le mystère plutôt que de l’éclairer.
Quand la science-fiction frôle le nanar (mais parfois touche)
L’un des reproches récurrents adressés au film concerne la qualité des effets numériques. À sa sortie, la critique a relevé un contraste entre l’ambition conceptuelle et la facture technique : certaines séquences, censées être saisissantes (dédoublements, distorsions temporelles, insertions géométriques), sont rendues avec des CGI qui jurent avec la texture des décors réels. Cela étant dit, le film compense par des choix de mise en scène — éclairages, découpe des plans, montages brusques — qui entretiennent l’angoisse. Quand la technique suit, la pièce impressionne ; quand elle déraille, le burlesque pointe et le spectateur sourit malgré lui.
Plus de philosophie que de chair
Le scénario, écrit par Sean Hood et retravaillé en production, tente de nourrir l’intrigue d’un vernis conspirationniste (l’organisation Izon, les expérimentations, la téléportation quantique) tout en préservant la mécanique dramatique du huis clos. On sent parfois les hésitations : faut-il expliquer, ou mieux vaut-il garder le mystère ? Le film oscille, et donne parfois l’impression d’avoir trop à la fois — trop d’idées, pas assez de temps pour les truffer d’émotion. L’alternative aurait été de resserrer l’angle psychologique : ici, on jongle entre la science-fiction pure et la parabole sociale, sans toujours trancher. La conséquence est un rythme inégal : phases très nerveuses alternant avec plages explicatives qui peuvent faire retomber l’attention.
Porteurs d’émotion ou figurants pris au piège ?
Sur le plan des interprétations, le film bénéficie d’un groupe solide. Kari Matchett impose une présence mesurée et vulnérable ; Grace Lynn Kung (dont le personnage cache des choses) apporte une fragilité ironique et un ressort émotionnel important. Les seconds rôles tiennent leur rang et contribuent à la montée de la suspicion — enjeu dramaturgique central. La critique a d’ailleurs relevé que, malgré certaines faiblesses formelles, le casting parvient à faire tenir la claustrophobie et la tension psychologique du récit. Autrement dit : les acteurs font le job, parfois au-delà des moyens qui leur sont laissés.
Fausses notes délicieuses
Passons à la partie que tu as demandée avec insistance : l’ironie et le burlesque. Hypercube contient plusieurs moments où la solennité se prend les pieds dans son propre argumentaire. Un ralenti trop appuyé, une duplication numérique qui ressemble à un mauvais photocollage, un dialogue technocratique livré comme une sentence : ces petites dissonances produisent une comédie involontaire particulièrement jouissive pour le spectateur sarcastique. Le burlesque ici n’est pas payé par des gags écrits, mais par la friction entre ambition sérieuse et réalisation imparfaite — et cette friction crée, parfois, des éclats de rire nerveux qui désamorcent la peur… et la rendent plus savoureuse. C’est de la comédie d’erreur, et moi, critique ironique, j’applaudis.
Mathématiques de l’angoisse
Malgré ses défauts, Hypercube conserve des séquences où le concept fonctionne pleinement : dérèglements d’horloge, cellules où l’on rencontre ses doubles, vieillissements accélérés — des images qui questionnent l’identité et la temporalité d’une manière singulière pour un film de « piège ». Ces fulgurances montrent que la franchise pouvait explorer autre chose que les lames et les broyeurs : elle peut devenir un laboratoire de l’étrangeté ontologique. À ce titre, le film ne mérite pas l’éreintement complet : il y a des moments de vraie science-fiction vidé de ses clichés et qui prennent à la gorge.
Mi-figue mi-raisin…
À la sortie, la réception fut globalement mitigée : certains critiques ont salué l’ambition et l’évolution conceptuelle par rapport au premier épisode, d’autres ont pointé la faiblesse des effets et l’éparpillement narratif. Les agrégateurs et revues spécialisées montrent un panel de réactions contrastées — ni triomphe, ni débâcle absolue. Cela dit, Cube 2: Hypercube a obtenu la reconnaissance de jurys de festival : Andrzej Sekuła a reçu le Critics’ Award (ex-aequo) au festival Fantasporto 2003, une mention qui reconnaît la dimension formelle et l’audace du projet malgré ses limites techniques.
Chef-d’œuvre raté ou nanar brillant ?
Allons-y sans faux col et avec un sourire : Hypercube est l’enfant un peu capricieux d’un concept brillant et d’un budget timoré. Il y a, dans ses meilleurs instants, quelque chose de profondément inquiétant — l’idée que notre réalité peut se défaire comme un tricot mal fermé — et ces instants suffisent à attester d’une vraie imagination. Mais en même temps, le film multiplie les décisions curieuses : des effets numériques qui trahissent la mise en scène, des dialogues qui prennent parfois la forme d’un cours d’introduction à la topologie, et une volonté de tout expliquer qui tue un peu le mystère. Le résultat ? Un film qui oscille entre le vertige et le sourire narquois. Pour les amateurs d’expériences bizarres et de science-fiction conceptuelle, c’est un plaisir coupable ; pour les puristes de la claustro-horreur minimaliste, c’est une déception modérée.
Faut-il le revoir ?
Si vous êtes du genre à étudier comment une idée peut être traduite à l’écran — et quelles concessions techniques cela implique — Hypercube est un cas d’école. Il montre la promesse et le danger de transformer un concept mathématique en spectacle visuel. Si vous cherchez de la peur pure et des sensations à l’ancienne, vous préférerez peut-être le film original. Mais si vous aimez les films qui pensent le genre et qui acceptent d’être bizarres, celui-ci mérite une place dans votre vidéothèque. Et surtout : regardez-le avec un ami cynique ; vous rirez des moments ratés et applaudirez les fulgurances ensemble.
Un cube aux arêtes coupantes… et un peu émoussées
Voici le bilan sans langue de bois : Cube 2 : Hypercube n’est pas un chef-d’œuvre, mais ce n’est pas non plus un gâchis absolu. C’est une suite ambitieuse qui élargit le concept initial, parfois avec brio, parfois avec maladresse. Le casting tient l’ensemble, la mise en scène dévoile des idées visuelles intéressantes et la partition conceptuelle (temps/espace/identité) offre des images qui restent en tête. Mais la technique et l’écriture ne suivent pas toujours, et le film bascule parfois dans le kitsch involontaire — ce qui, selon l’humeur, amuse ou agace. Bref : regardez-le si vous aimez que le cinéma vous fasse travailler la cervelle et, accessoirement, vous fasse sourire quand il échoue spectaculairement.
Partager cet article :
| Sur le même sujet
| Les plus lus

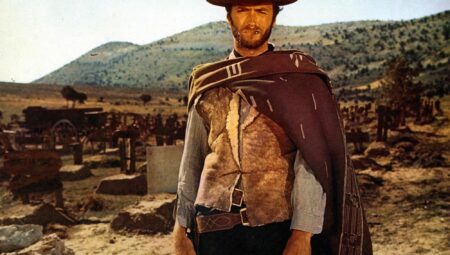











Soyez le premier à réagir