
La série qui refuse la facilité
La deuxième saison de The Last of Us n’est pas une simple suite attendue : c’est une opération de haute voltige narrative qui prend le pari risqué d’adapter la moitié la plus controversée et émotionnellement violente du jeu The Last of Us Part II. Là où la première saison avait séduit par sa douceur tranchante et sa fidélité tranquille au matériau source, la saison 2 choisit la dissonance. Elle nous met face à la conséquence : la vengeance, le trauma, la culpabilité et la radicalisation émotionnelle ne sont plus des ressorts de scénario mais des forces qui labourent les personnages. Le résultat est une saison polarisante et souvent bouleversante, qui divise autant qu’elle électrise — exactement le but quand on s’empare d’un récit conçu pour faire mal.
La trajectoire des cicatrices
Cinq ans après les événements dramatiques qui ont conclu la première saison, Joel et Ellie vivent une existence précaire mais apaisée à Jackson, Wyoming. La paix se fissure rapidement : les choix du passé resurgissent et entraînent les personnages loin de leur refuge. La saison 2 reprend le chemin narratif du jeu Part II, en suivant notamment deux trajectoires majeures — celle d’Ellie, confrontée à la quête de sens après la perte, et celle d’Abby, personnage venu d’un autre pan du récit dont la trajectoire de douleur et de vengeance prend une place centrale. Les épisodes alternent points de vue, tempos et registres, et n’hésitent pas à plonger le spectateur au cœur d’épisodes elliptico-violents où l’empathie se gagne à la sueur.
Qui tient la barre ? Les architectes de la saison
La série reste portée par ses créateurs/showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann, dont la collaboration a été la clé du ton — un équilibre précaire entre respect du matériau vidéoludique et nécessité de réinvention télévisuelle. La saison 2, pensée et écrite par l’équipe showrunner, s’appuie sur une distribution de réalisateurs chevronnés et variés : des signatures différentes pour des épisodes aux tonalités distinctes, une stratégie qui permet à l’ensemble de respirer tout en conservant une cohérence d’ensemble. Le choix d’alterner les réalisateurs et de jumeler chaque metteur en scène à un bloc thématique du récit aide la saison à conserver une densité émotionnelle et visuelle remarquablement maîtrisée.
Le casting — des visages qui habitent les plaies
Pedro Pascal reprend un rôle devenu iconique et conserve cette gravité minérale qui a fait de Joel une figure paternelle contradictoire. Bella Ramsey confirme, épisode après épisode, qu’Ellie est un personnage dont la complexité peut porter la série : rage contenue, humour noir, fragilité explosive — Ramsey navigue ces registres avec une justesse qui force le respect. Mais la grande nouveauté d’interprétation de la saison 2, c’est sans doute Kaitlyn Dever, qui incarne Abby — rôle central de Part II et source de nombreuses discussions. Sa performance, crue et nuancée, a attiré l’attention des cercles critiques et des jurys (nomination aux Emmy dans la catégorie Guest Actress), preuve que la série réussit à humaniser même les figures les plus controversées. Autour d’eux, Isabela Merced, Gabriel Luna et Young Mazino prolongent la famille narrative et apportent la solidité relationnelle nécessaire aux enjeux dramatiques.
Où et comment la saison a-t-elle été filmée ?
La saison 2 a largement pris l’air du Canada pour recréer l’Amérique post-pandémique : tournages en Alberta (Calgary, Exshaw, Fortress Mountain) et en Colombie-Britannique (Kamloops, Nanaimo, Mission, Fort Langley) ont permis d’alterner panoramas glacés, sous-bois menaçants et décors urbains en ruines. Cette géographie de la dévastation devient un personnage à part entière : routes désertes, forêts humides et villes vides servent la dramaturgie. Le tournage a été dense et itinérant, avec des périodes en extérieur exigeantes qui ont conféré aux scènes une sensation tangible de danger et d’usure. Le recours massif aux décors naturels, mêlé à des constructions de plateau très détaillées, donne à la saison une texture sensorielle — odeur, boue, froid — rarement atteinte dans la fiction télévisée contemporaine.
Style de réalisation et langue visuelle
La saison 2 use d’un cinéma télévisuel ambitieux : la photo favorise le plan serré et le mouvement au plus près des corps, la caméra à l’épaule rappelle l’origine vidéoludique immersive, et la découpe rythmique accepte le temps long lorsque l’émotion le requiert. Les réalisateurs sélectionnés pour la saison exploitent la lumière naturelle et les contrastes climatiques pour sculpter des tableaux visuels où la violence explose presque toujours hors champ avant de se révéler. Le montage, parfois volontairement heurté, brise la complaisance et oblige le spectateur à une lecture morale active — on ne regarde pas The Last of Us comme on consomme une série d’action : on y prend parti, on y souffre.
Les acteurs sont-ils à la hauteur ? Oui, et plus encore
La réponse courte est oui : la saison 2 demande des performances d’une rare amplitude émotionnelle, et ses principaux interprètes les délivrent. Pedro Pascal compose Joel avec une économie de geste qui dit la fatigue morale, tandis que Bella Ramsey assume l’ambiguïté d’une Ellie devenue à la fois victime et bourreau potentiel de sa propre histoire. Kaitlyn Dever, souvent au centre des débats, livre une Abby qui n’est pas une caricature de colère mais une femme forgeant sa survie dans la douleur. Les seconds rôles, parfois plus éphémères, offrent quant à eux des fulgurances : moments de tendresse, instants de trahison, séquences de violence qui ne sont jamais gratuites mais conçues pour révéler des couches psychologiques. Le casting transmet l’idée que la série n’a plus le droit à l’erreur : chaque regard, chaque geste compte.
Ce que la saison apporte de nouveau (et pourquoi ça compte)
Sur le plan formel, la saison 2 ne réinvente pas le médium télévisuel ; elle l’affûte. Son apport le plus singulier est narratif et moral : montrer une histoire de vengeance depuis plusieurs perspectives, en cherchant à rendre compréhensible — sans justifier — l’irréparable. Là où les séries d’action diluent la culpabilité dans l’adrénaline, The Last of Us met la culpabilité au centre et force le public à s’y confronter. Cette volonté de rendre la violence lisible, complexe et douloureuse — plutôt que spectaculaire — fait de la saison une œuvre qui questionne la responsabilité, l’identité et la résilience. En cela, elle renouvelle le registre post-apocalyptique par une haute exigence éthique.
Réception et récompenses — l’année des nominations
La critique a majoritairement salué l’ambition de la saison 2 : agrégateurs et grands médias ont souligné la qualité des performances, la mise en scène et la densité dramatique (Rotten Tomatoes affiche une nette approbation critique pour la saison et Metacritic signale un accueil très positif). Sur le plan des récompenses, la saison a été largement considérée lors des cycles de prix : nominations multiples aux Emmy Awards et dans d’autres palmarès ont confirmé que, malgré son ton clivant, la saison a trouvé l’estime des pairs et des professionnels. À titre d’exemple, la performance de Kaitlyn Dever (Abby) a été distinguée par une nomination aux Emmy dans la catégorie Guest Actress, signe que la série transforme la polémique en opportunité artistique.
Les éléments discutables (mais qu’on peut applaudir quand même)
Il faut être honnête : la saison n’est pas parfaite. Le tempo parfois inégal, l’étirement de certaines séquences et la nature volontairement provocatrice de l’adaptation peuvent fatiguer. Mais ces mêmes défauts sont aussi les marqueurs d’une série qui ose. Plutôt que d’effacer la violence derrière un vernis moral, la saison l’expose, la dissèque et la fait travailler pour qu’elle devienne sujet et non décor. Cette audace narrative mérite d’être saluée même quand l’exécution trébuche. En somme : on pardonne les cahots quand l’ambition est si clairement là.
Pourquoi cette saison mérite qu’on la voie (tout de suite)
Si vous cherchez une simple série d’action, passez votre chemin. Si vous cherchez une fiction qui prend la violence au sérieux, qui interroge la vengeance comme moteur tragique et qui met ses acteurs au défi, alors la saison 2 de The Last of Us est une expérience télévisuelle majeure. Elle éduque le regard du spectateur à travers des choix formels forts et renforce l’idée que l’adaptation peut être une transposition créative — non pas une copie — du jeu vidéo. Les récompenses et nominations confirment qu’on est face à une production qui parle autant aux institutions qu’au grand public.
Une saison qui blesse pour guérir
En transformant la douleur en matière dramatique, la saison 2 de The Last of Us fait le pari de la confrontation plutôt que de la consolation. Elle divise, secoue et, par-delà la polémique, élève le récit vidéoludique au rang d’art télévisuel capable de poser de vraies questions morales. Portée par des interprètes qui osent l’implication totale et par une équipe créative qui n’a pas peur de la rupture, cette saison reste, dans sa façon d’être blessante, profondément généreuse. C’est une série qui vous laissera meurtri, peut-être moins rassasié, mais incontestablement changé.
Partager cet article :
Je partages avec passion ses analyses affûtées et ses coups de cœur culturels. Cinéphile curieux, gamer invétéré et explorateur infatigable de sorties en tout genre, il aime plonger dans les univers variés que proposent les films, les jeux vidéo, les séries et les événements culturels. Pour moi, chaque œuvre est une expérience à vivre, à comprendre et à transmettre — avec justesse, humour et un brin de subjectivité assumée.
| Sur le même sujet
| Au hasard


| Les plus lus


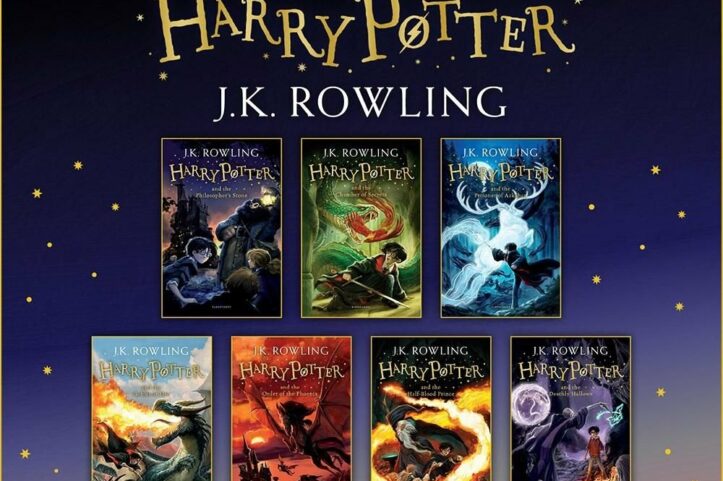


















Soyez le premier à réagir